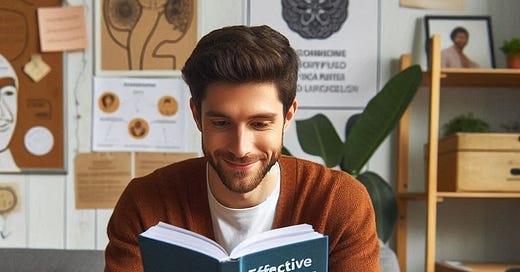Le psychologue
Imaginez avec moi un monde idéal. Dans celui-ci, les recherches en psychopathologie et psychothérapie visent à explorer et comprendre le fonctionnement d’un esprit humain, et ce qui fait qu’une psychothérapie agit sur ce fonctionnement (ou pas).
Comme ça, les praticiens n’ont pas besoin de faire au feeling ou d’apprendre sur le tas : lorsqu’ils reçoivent quelqu’un, ils priorisent les façons de faire qui présentent les meilleures chances de succès. Parce que ça serait dommage de ne pas s’appuyer sur l’expérience et les données de milliers de prises en soin a priori comparables qui ont été documentées. Et si ça ne marche pas ou semble trop éloigné du profil et de la situation de la personne, les dits-praticiens s’autorisent des ajustements éclairés, en collaboration avec le principal intéressé et en faisant preuve de transparence (= expliquer comment on procède et pourquoi on va procéder comme ça et qu’est-ce qu’on espère réussir en faisant ça).
Bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire. C’est horriblement compliqué de produire ces connaissances. C’est littéralement un métier tant ça suppose d’être pointu. Et il faut une attitude très particulière, presque inhumaine : il faut être ok pour se tromper voire changer d’avis.
Par contre, en postulant qu’on contrôle ce paramètre (ou qu’on le laisse aux gens dont c’est le métier), la question suivante est tout aussi intéressante. Comment s’assurer que les professionnels concernés aient accès à ces informations ? C’est l’étude de la dissémination des connaissances.
Bref : d’un point de vue très théorique et naïf, la recherche en psychothérapie et en psychopathologie est supposée aider à déterminer comment marche un humain, et les façons d’intervenir sur ce fonctionnement. Puis quand on pense avoir compris quelque chose qui semble pertinent ou qui a l’air d’avoir une quelconque efficacité, on essaye de le faire savoir.
Concrètement, cette diffusion peut se faire par plusieurs biais. L’un d’entre eux est de passer par la rédaction de guides ou de manuels.
Reste à déterminer s’ils sont lus. Une première étude avait été menée en 2000, auprès de psychologues cliniciens. Il y a une étude plus récente sur le sujet, de 2013, mais à l’échantillon plus large (« social workers, mental health counselors, marriage and family therapists »). A priori, la première de grande ampleur à explorer la question suivante : est-ce que les thérapeutes intègrent ces manuals dans leurs pratiques cliniques ?
Qu’est-ce qui ressort de cette étude ? De manière générale, l’utilisation systématique est rare. Ça semble logique : ce n’est pas une science exacte, l’application systématique a peu de chances d’être efficace. Si on regarde l’utilisation régulière, c’est très hétérogène. Ça semble dépendre de certaines variables. A priori, celle qui a la meilleure valeur prédictive serait l’orientation théorique et méthodologique. Mais il y en a probablement d’autres.
N’hésitez pas à consulter l’article (ici) pour en savoir plus, mais bien sûr en le payant parce que comme le souligne Pierre Bordaberry c’est parfaitement normal de payer (55,20 dollars) pour avoir accès au savoir scientifique et les pirates sont des coquins.
Ça pose question je trouve.
Aujourd’hui, le mode de dissémination des connaissances le plus employé est - à ma connaissance - la formation professionnelle continue. Mais avec quelle efficacité ? Parce que finalement, on se retrouve souvent avec des formations un peu en surface, qui répète ce qu’on trouve dans les ouvrages de référence - mais sans entrer dans le détail (et encore moins dans le concret).
Ça me rappelle une anecdote. En début de carrière, j’ai participé à la formalisation de certains de ces guides dans le champ de l’orientation professionnelle. Ça m’a valu de faire pas mal de formation sur les thématiques couvertes par les livres. J’étais encore un peu vert et naïf. J’avais demandé à mon éditrice : “mais pourquoi achètent-il la formation s’ils ont acheté le livre ? Il y a tout dedans, on s’est donné du mal pour qu’il soit le plus complet possible !”. Et elle m’avait répondu : “oui, mais ils ne le liront pas forcément.”
Bref : ils étaient prêts à payer pour que je leur raconte ce qu’il y a dans le livre.
Du coup, les manuels/guides sont peu utilisés - alors qu’ils sont a priori raisonnablement complets - et les formations sont largement investies - alors qu’il y a a priori moins à en attendre, et c’est plus cher.
Le psychiatre (et sa femme)
Alors le premier truc qui nous semble important de préciser c’est qu’il est important de distinguer deux types de supports scientifiques :
les articles scientifiques, on parle là des articles qui coûtent une blinde, mis en ligne par des éditeurs qui profitent d’un marché à plusieurs milliards de dollars qui ressemble plus au marché de la pop culture qu’autre chose - voire de la pornographie (oui oui).
les livres, et dans ce cas il existe à mon avis deux types d’ouvrages :
les livres issus d’un auteur unique, qui sont je trouve source de savoir expérientiel qu’il est difficile de trouver ailleurs ;
les livres rédigés par plusieurs auteurs, parfois incroyables, parfois complètement inutiles - très superficiels et d’aucune utilité.
Je n’ai aucun problème à payer un livre plusieurs centaines d’euros - même si les auteurs ne reçoivent pas grand chose. C’est d’ailleurs là que j’apprends le plus de choses - de très loin.
Mais les articles c’est hors de question. J’ai acheté quelques journaux, j’ai tout annulé - c’est une honte au bon sens, et les auteurs ne reçoivent rien.
En psychiatrie, on a deux problèmes:
Les gens en moyenne ne se forment pas. Et c’est pour une raison très simple, ils n’ont aucune obligation à le faire. C’est la base du comportementalisme. Aucune récompense, aucune punition, aucun renforcement, zilch, nada.
Je ne dis pas qu’il faut arriver dans un système comme aux USA où vous pouvez payer des centaines de milliers de dollars - et donc vous passez des heures à faire de la paperasse pour vous couvrir, mais nous sommes dans un autre extrême
Le monde idéal dont mon collègue a parlé n’existe pas. Le savoir est inexact, imprécis, fragmenté, perdu au milieu de choses plus fausses que vraies, et il est beaucoup plus important d’apprendre que nous ne connaissons rien que de se draper dans de fausses vérités.
A partir de là, la qualité des formations disponibles est tellement faible qu’en l’état il est nécessaire de les modifier avant de les disséminer, au risque de disséminer des conneries.
Je ne résiste pas à parler de Miller et Rollnick qui ont quant à eux étudié la problématique de la formation continue brève (qui est de plus en plus à l’honneur) sur 2-3 jours, et qui ne fait que donner une impression de compétence, avec au mieux des résultats nuls en terme d’amélioration de prise en charge ; et une dégradation de celle-ci dans certains cas.
Source
Becker, E. M., Smith, A. M., & Jensen-Doss, A. (2013). Who's using treatment manuals? A national survey of practicing therapists. Behaviour research and therapy, 51(10), 706–710. https://doi.org/10.1016/j.brat.2013.07.008